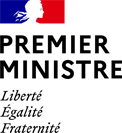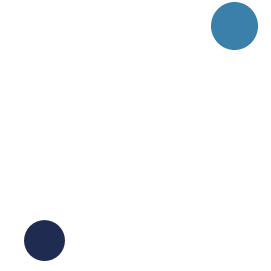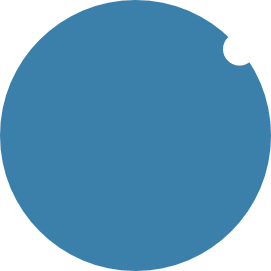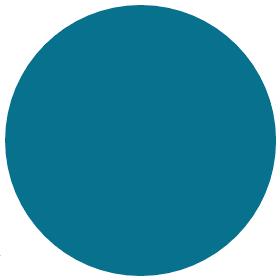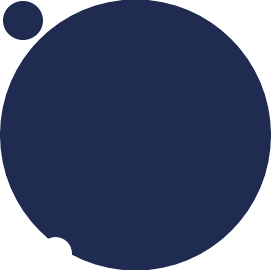Le SGAE suit l’ensemble des dossiers traités par l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE). Il coordonne le travail des différents ministères : préparation des instructions servant à l’expression de la France lors des réunions des comités et groupes de travail de l’organisation, et des commentaires de la France sur les différents documents de travail. Le SGAE valide les positions de la France et assure la diffusion des travaux de l’OCDE. Il s’assure également de la cohérence des positions de la France à l’OCDE et à l’Union européenne.
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dont le siège est à Paris, a pour mission de promouvoir des politiques de croissance économique de long terme et d’amélioration du niveau de vie des populations. Créée par la convention du 14 décembre 1960, elle succède à l’OECE, elle-même fondée en 1948 pour mettre en œuvre le plan Marshall. Elle compte aujourd’hui 38 membres, essentiellement des pays développés. Ses travaux s’appuient sur plus de 250 comités et groupes de travail qui rassemblent chaque année près de 140 000 experts issus non seulement des pays membres mais aussi de nombreux pays associés à ses travaux. Elle remplit une triple fonction, constituant (i) un creuset de production d’études et de statistiques, (ii) un espace d’échange et d’apprentissage de la coopération multilatérale et (iii) une instance de diffusion de normes et standards.
Aujourd’hui, ses travaux font une place beaucoup plus large aux aspects sociaux et environnementaux de la mondialisation, à la réduction des inégalités et à la définition de règles du jeu communes. Cette nouvelle orientation, qui se traduit dans sa devise « des politiques meilleures pour un monde meilleur », passe notamment par des travaux pionniers en matière de fiscalité internationale, de régulation du numérique ou encore de lutte contre la corruption. L’OCDE est également un acteur reconnu pour la définition des politiques d’aide au développement, à travers les travaux de son Comité d’Aide au Développement (CAD) qui réunit 31 des principaux pays fournisseurs d'aide dans le monde ainsi que l'Union européenne. L’OCDE joue ainsi un rôle central dans la production d’un droit souple international, reposant sur des standards, normes et classements qui se diffusent dans le monde entier.
En tant que pays hôte, la France entretient une relation particulière avec l’OCDE, vitrine de l’attractivité de Paris pour les organisations internationales. L’OCDE est une enceinte d’expression privilégiée de la vision française d’une mondialisation mieux régulée et plus inclusive.